« La sainteté… autrement »
dans Des saints, des justes, Collection Mutations, éd. Autrement, 2000, p. 28-42.
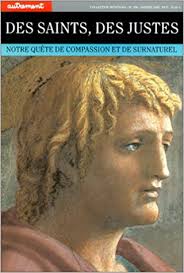
Qui n’a en mémoire l’étrange pensée qui a associé un moment, par le truchement de ce terme, mère Teresa de Calcutta et la princesse Diana, mortes à peu de temps d’intervalle ? Ainsi le mot circule, investi de sens variés qui peuvent l’attirer loin de toute référence religieuse. Mais, au fait, de quoi parle-t-on donc quand on parle de sainteté ? « Ce n’est pas cela… », objectait Thérèse de Lisieux, quelques jours avant de mourir, aux propos pieux de sa sœur admirant sa « perfection ». Sans même parler de la vivre, définir la sainteté ne va pas sans difficulté.
Je lui disais qu’elle avait dû beaucoup lutter pour atteindre le degré de perfection où nous la voyions. Elle me répondit avec un accent indéfinissable : Oh ! Ce n’est pas cela…
Thérèse de l’Enfant-Jésus
La sainteté intéresse aujourd’hui, avec tout ce que cette proposition implique de curiosité distante, dégagée, avec ce qu’elle comporte aussi probablement de secrète nostalgie. De façon vague mais tenace, le mot rend à désigner des générosités désintéressées, des abnégations radicales aussi bien que telle ou telle attitude de résistance à l’oppression. La sainteté sert à qualifier, pêle-mêle, des personnalités qui incarnent, réellement ou fantasmatiquement, de grands dévouements. Qui n’a en mémoire l’étrange pensée qui a associé un moment, par le truchement de ce terme, mère Teresa de Calcutta er la princesse Diana, mortes à peu de temps d’intervalle ? Ainsi le mot circule, investi de sens variés, qui peuvent l’attirer loin de toute référence religieuse. Gagnant en extension, il perd évidemment en contenu, au point de devenir une notion exsangue faisant série avec d’autres concepts mous qui se multiplient aujourd’hui dans le champ des « spiritualités ». On en oublierait presque ce fait que, dans notre monde européen dont le judéo-christianisme demeure, à tout le moins, la matrice culturelle, une réalité comme la sainteté a un contour précis, spécifique, quelle est solidaire d’une manière de connaître la vie humaine, son sens, son but. En rigueur de termes, de quoi parle-t-on donc quand on parle de sainteté ? La question est vaste au point de décourager un propos nécessairement limité. Bornons d’emblée notre ambition : il ne s’agira que de suggérer une complexité près de laquelle on risque de passer en l’ignorant, de débusquer quelques malentendus qui guettent cette question, qu’on l’aborde d’ailleurs côté incroyance ou côté croyance. « Ce n’est pas cela… », objectait Thérèse de Lisieux, quelques jours avant de mourir, aux propos pieux de sa sœur admirant sa « perfection »[1]. Sans même parler de la vivre, définir la sainteté ne va pas sans effort. [1] Thérèse de Lisieux, Novissima Verba, 112.
La démesure et l’exception
Premier temps : laisser se former les images, les réminiscences qu’apporte le mot. D’une certaine manière, le monde des saints est notre voisinage immédiat. D’une familiarité qui fait qu’on ne le voit même plus. Avant même de franchir le seuil de nos églises, les noms de nos villes, de nos rues, de nos stations de métro parlent des saints. Nos cités sont construites, pour beaucoup d’entre elles, au lieu où un sanctuaire a commencé à honorer la mémoire d’un saint autochtone ou à célébrer le culte des reliques d’un saint plus lointain. Les routes de pèlerinage, de sanctuaire à sanctuaire, ont été les grandes artères où ont circulé la vie et la culture de l’Europe. Le quotidien des populations citadines et rurales est tissé du souvenir des saints. Familiarité donc, jusqu’à l’invisible, mais qui débouche sur son contraire dès que l’attention accommode sur elle. Alors surgit, tiré de la pénombre où il se tient pour la plupart de nos contemporains, le monde des saints, l’inverse du quotidien. À la lettre, monde de 1’extra-ordinaire. D’abord parce que le propre des saints, se dit-on, c’est de n’être pas de la commune humanité. Dans la mesure même où le saint est celui dont le souvenir dure, alors que tout autour de lui a sombré dans la poussière et dans l’oubli, il appartient au monde de l’exception. En outre ce monde est un monde de récits, les saints, dans la mémoire culturelle, ce sont d’abord des récits de vies censés garder le souvenir de tout ce qui précisément distingue une vie du banal quotidien et l’établit à proximité du divin. Ainsi, au fil des siècles, s’est constitué un corpus de légende, le mot étant à entendre, selon son étymologie, comme « ce qui doit être lu ». Dès les premiers siècles du monde chrétien, on fixe le souvenir des martyrs, fidèles à la confession du nom du Christ dans la tourmente des persécutions. De là naîtront les passiones témoignages d’une vie chrétienne qui accepte d’être configurée à celle du Christ jusqu’à la mort incluse. Puis la Vie de saint Antoine rédigée par Athanase dans la seconde moitié du IV siècle, inaugure la littérature monastique en livrant un récit destiné à une longue carrière dans la culture occidentale. De siècle en siècle va s’accumuler dès lors un riche patrimoine hagiographique dont La Légende Dorée de Jacques de Voragine recueillera l’héritage au Moyen Âge. Des fioretti se formeront autour des grandes figures que la piété populaire entoure de sa vénération.
De proche en proche, s’élabore un monde de la sainteté qui parle à l’imaginaire d’événements hors du commun. Grands retournements de conversion imprévisibles, miracles qui se glissent dans le quotidien, gestes de thaumaturge, combats terrifiants contre des démons qui reconnaissent dans le saint l’ennemi à abattre. Mais aussi navigations miraculeuses sans rames, voiles ni gouvernail, coopérations merveilleuses de la nature qui vient au secours du saint en péril, rencontres réconciliées, sans menace ni violence, du monde animal et du monde humain. Ici des corbeaux nourrissent les ermites Paul et Antoine perdus dans des solitudes inaccessibles. Un lion menaçant, soigné par la main de saint Jérôme, devient un paisible gardien de bétail. Le loup qui terrorisait la cité de Gubbio accepte le pacte de non-agression que lui propose saint François. D’autres façons encore, ce monde des saints est marqué par l’excès. Ainsi, des récits de supplices. Le texte de Jacques de Voragine est rempli d’épisodes qui rivalisent de cruauté extravagante, d’héroïsme inouï. Les femmes, exposées les premières au sadisme, fournissent le plus gros lot d’histoires de ce genre. Eulalie est successivement déchirée avec des crocs de fer, jetée dans un chaudron d’eau bouillante, livrée aux flammes du bûcher avant d’être finalement décapitée. À sainte Agathe, le bourreau arrache les seins à 1’aide d’une tenaille. Mais les supplices concernent aussi les hommes : l’histoire de saint Quentin, parmi beaucoup d’autres, fournit un catalogue époustouflant de tortures affreuses, que le récit détaille avec une complaisance évidente.
À tout cela s’ajoutera plus tard, dans la littérature hagiographique, la mention de phénomènes que l’on nommera « mystiques », en employant un mot d’ailleurs bien ambigu; extases, visions, révélations, prophéties, ajoutent leur mystère intimidant au monde de la sainteté. Le XXe siècle n’évoque plus de figures de stylites, celles de ces ascètes des premiers siècles vivant des années durant sur une colonne, mais les demandes de canonisation qui sont présentées aujourd’hui, à Rome, à la Congrégation pour la cause des saints, concernent, à l’occasion, des personnalités dont la vie est marquée d’événements ou de phénomènes très insolites. Ce présent continue une histoire où la sainteté est synonyme d’extrême, souvent d’ailleurs simplement à travers la mention d’une perfection qui est réputée, on le sait, « ne pas être de ce monde ».
Tel est précisément le monde qui sert aujourd’hui de base à des enquêtes psychosociologiques en quête de définitions et d’interprétations de la sainteté. Aux antipodes de la crédulité populaire dans leur démarche, elles font de ces récits, qu’elles soumettent à la critique, leur corpus de référence. On y aborde volontiers la sainteté par le seul biais d’ « existences brisées » selon l’expression du sociologue Jean-Pierre Albert, ou encore en privilégiant certains aspects de sainteté féminine. On trouve dans La Légende Dorée, incontestablement, un matériel commode et facile à exploiter pour illustrer et valider des analyses contemporaines sur les rapports de la femme et du sacré. Mais surgit un problème qu’il nous faut maintenant considérer : n’est-on pas, ce faisant, en train de construire une définition de la sainteté qui ne prend en considération que ses marges? Plus précisément, ne prend-on pas pour centre, en fait, des marges qui dès lors ne peuvent plus recevoir l’éclairage de ce centre ? Ainsi le marginal grossit, grandit démesurément, et avec lui s’épaissit l’étrangeté. Il ne reste plus alors d’autre issue que de réduire celle-ci en lui appliquant des grilles qui ramènent au connu le différent, empêchant définitivement d’accéder à une intelligence vraie de la réalité que l’on prétend saisir. Au terme de 1’analyse, on n’a fait que valider des pensées préalables. Mais alors, quel est ce centre qu’il faut retrouver avant toute interprétation ?
Aux sources de la sainteté
Pour le cerner, il nous faut lever une première équivoque, celle qui consiste à assimiler la sainteté de la tradition chrétienne au monde des hommes et des femmes canonisés, c’est-à-dire objets d’une reconnaissance publique et d’une vénération spéciale dans l’Église. Comme si ces deux réalités étaient identiques, de même taille, et donc interchangeables. Comme s’il suffisait de se plonger dans les récits de La Légende dorée pour être assuré de comprendre quelque chose à la sainteté chrétienne et – parlons concrètement – pour comprendre quelque chose aux chrétiens d’aujourd’hui qui, dans l’ordinaire d’une vie commune, ont le désir de la sainteté et aiment les saints d’une amitié simple et familière.
« L’arbre risque » en effet, de cacher la forêt. Entendez l’arbre : le récit du discours hagiographique que l’on vient d’évoquer avec son imaginaire puissant. Entendez la forêt : la voix, initialement plus ténue, mais forte de son autorité fondatrice et de beaucoup de relais au fil du temps, qui, dans la tradition biblique exprime ce qu’est la sainteté et en fait l’injonction qui retentit sur tout un peuple et, à terme, sur toute vie humaine. Ainsi tout récit de vie édifiante est précédé d’un autre récit : celui que la tradition d’Israël, puis celle de d’Eglise, désigné comme Alliance. Car ici, au centre de la dramatique de l’histoire, est placée l’affirmation que Dieu fait alliance avec le peuple qu’il a choisi pour remodeler, par son intermédiaire, la création première. Dieu y déclare qu’il s’engage à faire vivre qui s’engage à vivre la justice que lui, Dieu, montre en donnant la Loi : « Vous serez saint parce que, moi, votre Dieu, je suis saint» (Lévitique 11, 44, puis 11,45, puis de nouveau 19, 2). Il s’agit pour tout un peuple d’être kadosh, saint, parce que Dieu est saint » pour être saint comme Dieu. Derrière ce commandement se loge une anthropologie précise, celle qui, dès les premiers versets de la Genèse, définit l’homme comme « image de Dieu » et voit l’accomplissement de l’humanité de l’homme dans la réalisation de cette image.
Kadosh donc, 1’homme sera, pour être homme selon son identité vraie. Le mot exprime, au départ, simplement la séparation qui distingue ce qui est sacré de ce qui ne l’est pas. Mais la loi biblique déborde très vite cette acception limitée et restrictive. Est kadosh celui qui participe de la sainteté de Dieu, de sa justice, c’est-à-dire identiquement de sa vie. Et la Loi désigne le chemin de cette sainteté ; elle balise le chemin qui conduit jusqu’à la vie de Dieu. La sainteté est en quelque sorte une imitatio Dei qui arrache l’homme à la mort. « Car la sainteté, c’est la vie enfin libérée de la mort », écrit le théologien orthodoxe Olivier Clément.
Telle est la charte fondatrice de toute sainteté en régime chrétien, rigoureusement enracinée ici dans la foi d’Israël. Le Nouveau Testament en reprendra la formule : « Vous serez parfaits comme est parfait votre Père des Cieux » (Mt 5, 47). La spécificité du christianisme sera d’affirmer que ce commandement ne peut s’accomplir que dans une humanité qui reçoit du Christ la force de le vivre. Mais avec le christianisme aussi, ce qui était au départ à la charge du seul Israël deviendra la vocation de toute l’humanité. On est donc loin de l’élitisme que suggérait précédemment le discours hagiographique. La liturgie chrétienne chante d’ailleurs : « Un seul est saint, Jésus-Christ. » Tout être humain, créé à l’image de Dieu, est fait pour participer à cette sainteté. C’est pourquoi les premiers textes de la tradition chrétienne désignent la communauté comme I’ « Église des saints » : « Vous donc les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés », écrit Paul a ses correspondants de la ville de Colosses ; à ceux de Rome : « Vous donc, les saints par vocation, les bien-aimés de Dieu » ; il parle à ceux d’Ephèse de celui qui « nous a élus en lui dès avant la création du monde pour être saints et immaculés en sa présence dans l’amour » (Ép 4,1). La première Lettre de Pierre emploie le même langage : « De même que celui qui nous a appelés est saint, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite. » La Lettre à Diognète, un peu plus tard, assure : « En aimant Dieu tu seras un imitateur de sa bonté, et ne t’étonne pas qu’un homme puisse devenir un imitateur de Dieu : il le peut, Dieu le voulant. » A l’autre extrémité du temps, au XXI siècle, le concile de Vatican II développe dans Lumen Gentium la même conception, en parlant d’un appel universel à la sainteté dans l’Eglise.
Finalement, la sainteté est la communion de ceux qui aiment, puisqu’en tout cela, ultimement, il s’agit d’aimer, sachant que l’être de Dieu est amour. « Les saints, disait Bernanos, ont le génie de l’amour. » Ils l’ont en aimant Dieu et en aimant leurs semblables, selon ce que la Bible tient pour le bon ordre de l’amour. De sorte que le vrai critère de la sainteté est simplement l’amour. Principe de discrimination simple et décisif : tout ce qui ne sert pas l’amour est étranger à la sainteté. Thérèse de Lisieux dit sobrement que « le mérite ne consiste pas à faire ou à donner » mais « à aimer beaucoup ». On voit le tri que ce principe opère, qu’on l’applique aux œuvres de l’ascèse ou aux thèses de l’altruisme humanitaire. Le stylite qui ne fait que tirer gloire de sa prouesse rate la sainteté. Ivan Karamazov, qui se révolte contre l’injustice, la rate tour autant dès lors que, comme le lui fait remarquer Aliocha, il n’aime pas en fait les hommes dont il plaide la cause.
Amour et solidarité – ou, pour mieux dire, communion, en utilisant un terme biblique – qualifient donc la sainteté chrétienne. Un autre trait doit être souligné : cette sainteté désigne sa source, elle ne cherche pas à faire admirer l’homme, ses générosités ou ses héroïsmes. Ce à quoi s’arrêtent les sagesses. Elle se sait et se veut le reflet du seul Saint. Elle ne s’affiche pas. Elle s’efface au contraire pour que le regard la traverse vers Dieu. C’est lui qu’elle veut révéler. Vers lui qu’elle veut conduire et tourner. Elle ne dit pas : « Admirez-moi ! » mais : « Célébrez-le ! » La vertu ici retrouve son sens initial : elle est force, mais reçue par l’homme de plus loin que lui. Ce qui fait que la sainteté va bien avec la pauvreté. Qu’elle a une affinité avec ce qui est caché. Déjà, saint Augustin célébrait les saints cachés. Thème auquel Jean Tauler, au XIV siècle, fait écho : « […] Personne ne les connaît, sinon ceux qui leur ressemblent: on ne peut voir leur sainteté… C’est comme 1’or enfoui dans la terre ; c’est un trésor caché qu’ils portent au fond de leur âme ; l’homme qui est tout extérieur ne peut l’apercevoir. »[1] Sainteté commune de la vie ordinaire dont parle une contemporaine, Madeleine Delbrel : « Il y a des gens que Dieu prend et met à part ; il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire. Ce sont des gens de la vie ordinaire, les gens que l’on rencontre dans n’importe quelle rue… Nous autres, gens de la rue, nous croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. »[2] [1] Jean Tauler, Institutions, chapitre 3. [2] Madeleine Delbrel, Nous autres gens de la rue, Paris, Seuil, 1966.
Un doigt pointé
Nous voilà loin, semble-t-il, de l’hagiographie avec ses radicalités, ses tortures endurées et, pour finir, l’or des autels. Est-ce à dire que les saints canonisés seraient une contrefaçon, ou une version dénaturée, de cette sainteté cachée ? Non, mais c’est rappeler que la sainteté canonisée commence par là, ne trouve son sens que sur fond de ces pensées, et sa vraie portée que replacée dans cette lumière. Paul écrivait aux Corinthiens : « Désormais votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. » Des vies comme celles de saint Bernard, de saint François ou de sainte Thérèse d’Avila, si publiques soient-elles en leur temps, et si livrées soient-elles à la vénération collective après leur mort, ne peuvent être étrangères à cette logique, si c’est bien de sainteté que l’on parle à leur propos. En fait la sainteté canonisée n’existe que comme miroir grossissant d’une réalité beaucoup plus vaste que ne le laisserait penser le nombre, somme toute bien modeste, des saints connus et célébrés. Le culte des saints, aux origines de l’Église, commença avec la mémoire des défunts associés à « la foule immense des témoins » que désigne le livre de l’Apocalypse. Parmi eux, on dégagea progressivement des témoins privilégiés qui exprimaient plus fortement que d’autres la vocation de tous. On les honora en même temps que l’on transmettait le récit de leur vie aux nouvelles générations. On les raconta pour exhorter à l’endurance de la foi, à la vie morale, pour affermir le courage, pour faire démonstration de la puissance de Dieu dans une vie saisie par lui. L’histoire du jeune saint Louis de Gonzague jouant à la balle, auquel on demande ce qu’il ferait s’il apprenait qu’il devait mourir dans l’heure et répondant : « Je continuerais à jouer », enseigne, mieux que des exhortations, le sens de l’abandon confiant et serein à la volonté de Dieu. Le récit de la fin de Maximilien Kolbe, mourant de faim et de soif dans un bunker après avoir pris la place d’un père de famille, montre au-delà de tout discours ce que signifie être disciple du Christ, donnant sa vie pour sauver celle de l’autre.
L’histoire de la manière dont l’Église « fait les saints » au long des siècles est certes complexe, traversée de toutes les réalités, voire des intérêts, qui tissent normalement la vie d’une collectivité[1]. Il reste que, dès que l’on accommode non sur les marges mais au centre, la fonction des saints canonisés apparaît clairement : elle est simplement de représenter, d’exemplifier ce qu’enseigne la foi, d’exhorter à le vivre, d’en avoir le désir. Un sermon de saint Bernard pour la Toussaint illustre ce dernier point. Celui-là même qui sera désigné un jour comme une des plus hautes figures de la sainteté médiévale y livre un petit traité précisément sur le bon usage des saints. Il commence par interroger : « Pourquoi célébrer cette multitude des saints alors que le Père les honore lui-même dans le ciel, selon la promesse du Fils ? De nos honneurs, ils n’ont nul besoin ! » Et il répond par une triple raison. La première est « le désir de me réjouir dans leur communion, d’obtenir d’être leur compagnon », car, dit-il « les saints nous désirent… les justes nous espèrent. » La seconde est de « voir le Christ » comme les saints le voient, « lui qui est notre vie », ajoute-t-il. Enfin la troisième raison est de partager la gloire du Christ quand celui-ci « restaurera notre corps d’humilité pour le configurer à la gloire de la Tête qu’il est lui-même »[2]. Trois raisons qui sont trois désirs que la pensée des saints attise en saint Bernard. Léon Bloy, plus tard, parlera autrement mais encore de désir, quand il écrira en finale de La Femme pauvre: « Il n’y a qu’une tristesse… c’est de n’être pas des saints. » [1] Voir Yves Chiron, Enquête sur les canonisations, Paris, Perrin, 1998. [2] Saint Bernard de Clairvaux, Cinquième sermon de Toussaint.
Sous l’éclairage de l’essentiel
Rien d’étonnant dès lors à ce que le récit de vies saintes soit tenu dans le monde chrétien pour un véritable mode d’enseignement, et cela au-delà même des besoins d’une catéchèse populaire. Après tout, la Vie de saint Antoine, pour prendre l’exemple d’un document fondateur de l’Occident chrétien, n’est pas un texte écrit par un naïf pour des naïfs. L’imagination d’un Bosch, d’un Bruegel ou d’un Flaubert s’est emparée de ces pages au cours du temps, les réduisant dans la mémoire à de simples diableries. Mais Athanase qui écrivit cette vie, fut 1’un des plus grands esprits du IV siècle, champion de la lutte contre les Ariens, auteur d’œuvres théologiques majeures. S’il composa là une oeuvre de théologie populaire destinée à l’édification, cela ne signifie pas qu’il écrivit comme on se délasserait de la rigueur théologique en s’adonnant à récriture de fables. La bonne lecture est celle qui commence par identifier le genre littéraire dont relèvent ces pages et qui ne se confond pas avec ce que nous appelons une biographie, même si Athanase connut très bien Antoine. C’est en fait un langage qui s’élabore ici, capable de placer une vie humaine dans la sphère de l’intervention de Dieu. L’objectif est de montrer une vie chrétienne qui s’édifie comme une suite de conversions et s’enfonce progressivement dans le mystère de Dieu. Les combats contre les démons qui ont tant frappé l’imagination des lecteurs d’Athanase sont la manière de dire un affrontement spirituel que Rimbaud qualifia, on le sait, de « plus brutal que bataille d’hommes ». Antoine est montré au désert, luttant contre les assauts des démons pour suggérer une participation au combat du Christ qui, au désert aussi fut soumis à la tentation du pouvoir et de l’idolâtrie. De même, la domination des bêtes sauvages, qui appartient aux topoï de l’eschatologie, est manière d’évoquer une vie réconciliée avec la création parce que réconciliée avec Dieu. Contrairement aux apparences, cette imagerie n’a pas pour but de placer la vie d’Antoine dans une extravagance lointaine, mais de figurer la profondeur de ce qui se vit dans le quotidien, dès l’instant qu’il est saisi dans son épaisseur spirituelle.
Ce qui est vrai du texte de saint Athanase l’est aussi du vaste corpus de textes hagiographiques où prolifère le miraculeux. Que celui-ci y atteigne si souvent les corps suggère que l’action divine n’est pas limitée à un spirituel évanescent, mais atteint l’homme vivant, entier, corps et âme. L’incarnation est centrale en cette tradition religieuse. De là tant de récits de guérisons, d’évocations de corps marqués de signes du Christ. De même encore, que la violence soit si présente dans les vies de saints que décrit un Jacques de Voragine relève probablement à certains moments d’une complaisance trouble, d’un sadisme rampant que, modernes, nous illustrons par d’autres voies. Mais elle signifie aussi tout simplement la force du mal qui travaille la condition humaine et qui, l’hagiographe en est convaincu, se dévoile d’autant plus qu’elle rencontre son envers en la personne du saint.
La tentation est évidemment de s’arrêter à cette surface du récit, de ne retenir de l’« expérience de Dieu » que les modalités de l’expérience… C’est ce qui s’observe dans les approches psychosociologiques que l’on évoquait plus haut. C’est ce qui se retrouve aussi dans des attitudes de crédulité croyante. On y néglige ce fait, par exemple, que les phénomènes paranormaux n’interviennent pas en faveur d’une canonisation. Ou encore, que la tradition chrétienne, dans le texte même des Évangiles, met en garde contre un mauvais usage du miraculeux : ainsi, il est promis aux disciples du Christ qu’ils puissent chasser en son nom les démons, mais, à l’inverse, le fait de chasser les démons ne garantit pas que l’on soit du Christ. A ceux qui, au jour final, protesteront de leurs qualités pour entrer dans le royaume des cieux en disant : « Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en Ton nom que nous avons prophétisé ? En Ton nom que nous avons chassé les démons ? En l’on nom que nous avons fait bien des miracles ? » il sera répondu, précise l’Évangile de Matthieu : « jamais je ne vous ai connus ; écartez-vous de moi vous qui commettez l’iniquité », car, déclare Jésus, « ce n’est pas en me disant Seigneur, Seigneur, que l’on entre dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (MT 7,21-23). Une partie au moins de l’histoire du culte des saints, qui se continue aujourd’hui en récits de statues qui saignent ou de prédictions insolites, témoigne que ces mots de l’Évangile n’ont pas été entendus partout. À installer la sainteté dans le seul registre du paranormal, on en évacue le sens spirituel, on la tue simplement.
Le problème est bien de consentir que les saints disent ce qu’ils disent, au-delà de ce que sait déjà le scepticisme ou de ce que sait la croyance. Il s’agit dans tous les cas de recevoir le choc d’une altérité dérangeante. Kenneth L. Woodward, éditorialiste à News-Week, pointe dans un ouvrage intitulé Comment l’Église fait les saints cette tendance à édulcorer la sainteté en la ramenant à des schémas connus, y compris dans son traitement confessionnel. À quoi il objecte : « Les saints, tels que je les imagine, devraient nous surprendre, non pas confirmer nos présomptions morales ou théologiques. Leurs histoires devraient nous rappeler non pas l’excellence de la vie vertueuse, mais l’imprévisibilité du domaine où s’engage un être qui se laisse transformer par la logique d’une vie vécue en et à travers Dieu. »[1] La sainteté autrement, donc. Henri de Lubac ne dit pas autre chose quand il évoque en des phrases d’une rhétorique qui semblerait parente de celle de Zarathoustra le saint qu’il appelle de ses vœux : « Il faut bien nous persuader d’avance que le saint que nous attendons ne sera guère conforme à nos conceptions, à nos pronostics ou à nos désirs. Quand il sera là, il nous choquera peut-être : au moins nous déroutera-t-il… Dans sa double nouveauté, il sera aussi un saint de toujours : manifestation doublement nouvelle de cet unique Homme Nouveau qui, n’étant pas du temps, ne répète pas le passé, mais est bien de toujours parce que reflet de l’Eternel. »[2] [1] Kenneth L. Woodward, Comment l’Eglise fait les saints, Paris, Grasset, 1992, p.427. [2] Henri de Lubac, Paradoxe et Mystère de l’Eglise, VII, Paris, Aubier, 1967.
On évoquera brièvement en finale deux figures proches dans le temps, qui illustrent chacune à sa manière la sainteté intempestive. La première est celle d’une sainte consacrée, canonisée, la plus populaire de ce XXè siècle probablement, que l’on mentionnait déjà en ouverture : Thérèse de Lisieux. À certains égards, on ne peut imaginer plus conforme aux stéréotypes de 1’hagiographie que la jeune carmélite entourée de roses sur son lit de mort. Tout est pourtant beaucoup plus compliqué et beaucoup moins conforme dans ce destin. L’analyse psychologique s’est essayée à en rendre raison. Mais l’essentiel échappe aux mailles du filet, comme il a d’ailleurs échappé aux proches de la sainte. Parmi elles, certaines ne virent que banalité insignifiante, comme cette sœur qui, peu de temps avant la fin de Thérèse, se demandait ce qu’on pourrait bien raconter d’elle après sa mort. Céline, la sœur complice et si proche religieuse dans le même carmel, n’échappa pas complétement non plus au malentendu. Soupirant un jour, alors qu’elle se comparait à Thérèse : « Oh ! Quand je pense à tout ce que j’ai à acquérir », elle s’attira promptement le rectificatif de sa sœur : « Dites plutôt à perdre ! » L’accent indéfinissable qui accompagna le « Ce n’est pas cela… » de Thérèse contestant que la sainteté se ramène à une perfection abstraite laisse pressentir comme un découragement, la crainte qu’on ne puisse décidément s’entendre. Et il a fallu en effet l’intelligence perspicace d’un Bernard Bro pour mettre en lumière tout ce que cette vie avait comporté de combat et, plus inattendu, de solidarité avec l’incroyance de son temps. Car Thérèse est contemporaine de Nietzsche, de Dostoïevski, de Lautréamont, non seulement par la chronologie, mais par la rudesse de son affrontement à la souffrance, au mal, au désespoir, à Dieu même. Les derniers mois de sa vie sont pris dans la ténèbre de ce qu’il faut appeler le désespoir et la tentation du suicide, au creux même de la foi. Cette sainteté ne se peint pas avec des pastels. Elle a la même gravité que celle qui habitait la jeune fille de quatorze ans engageant toute sa foi et ses forces pour obtenir la conversion du condamné à mort Pranzini. Mais c’est en regardant par là que l’on prend la mesure et le sens de la sainteté véritable de Thérèse.
Une autre figure suggère beaucoup. Elle est celle d’un homme qui n’est pas aujourd’hui un saint canonisé, mais autour duquel s’est ouvert il y a quelques années un débat très éclairant. Il s’agit de Jacques Fesch, condamné à mort et exécuté le 1er octobre 1957 pour le meurtre d’un policier. Son procès en 1955 avait déjà déclenché passions et polémiques. La publication en 1971 d’un recueil de ses écrits de prison, Lumière sur l’échafaud[1], allait ramener 1’attention sur lui. Deux autres publications en 1980 et 1989 ont achevé de livrer l’histoire de cet homme qui, dans les quelques mois de son incarcération, a vécu une conversion qui l’a mené au cœur de la foi chrétienne. Son cas alimenta le débat sur la peine de mort. On a dit que le condamné exécuté à l’aube dans la prison de la Santé n’était plus l’homme qui avait tué deux ans plus tôt. Oui et non. Ce qu’attestent son journal et ses lettres est qu’il avait dans l’intervalle rencontré le visage bouleversant d’une grâce où tout venait s’éclairer à neuf : vie, culpabilité, amour, mort. Les mots où il dit ce chemin sont sobres et forts. On ne les résume pas. On y reconnaît seulement le ton de la foi chrétienne la plus authentique et la plus avancée en direction du mystère de la grâce et de la rédemption. Cet homme est mort en connaissant et en montrant « l’infini de l’amour divin », que le crime qui le faisait condamner n’avait pas découragé. Beaucoup de lecteurs de ces textes ont été atteints par cette parole de feu et de paix, surgie du creuset de la prison et qui dessine comme un tableau de Rouault le visage du Christ. Ainsi, de proche en proche s’est formée l’idée d’une possible béatification de Fesch. L’archevêque de Paris s’en est fait normalement le porte-parole, convaincu de la force du signe que représenterait ce geste. Le premier « saint » de l’Église, le « bon larron » n’était-il pas d’ailleurs un condamné crucifié en même temps que Jésus ? [1] Jacques Fesch, Lumière sur l’échafaud, Paris, Editions ouvrières, 1972.
On ne sait pour l’heure ce qu’il adviendra du projet. Ce qui est sûr, c’est que la polémique s’est levée, avec ses malentendus, ses idées toutes faites, de « gauche », de « droite » ou de nulle part, toutes également déconcertées devant le message de Jacques Fesch, comme le remarquent les auteurs d’un ouvrage paru naguère, L’Affaire Jacques Fesch[1]. Tout cela signifie peut-être que l’on n’a pas encore assez lu Dostoïevski, lui qui savait que la sainteté ne contourne pas la faiblesse ou même le crime, mais qu’elle est toujours le travail de la grâce dans une âme pauvre. Peut-être décidément faut-il relire sainte Thérèse de Lisieux pour voir la sainteté autrement, Thérèse qui écrivait peu avant sa mort ces mots que contresigne à la lettre la vie de Jacques Fesch : « Dites bien, ma mère, que si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même confiance, je sentirais que cette multitude d’offenses serait comme une goutte d’eau dans un brasier ardent » (Novissima Verba). Bernanos, grand lecteur de Thérèse, se demandait si le contraire de la sainteté, la damnation, ne serait pas de « se découvrit trop tard, beaucoup trop tard, après la mort, une âme absolument inutilisée, encore soigneusement pliée en quatre, et gâtée comme certaines soies précieuses, faute d’usage »[2]. Les saints sont hommes qui ont déplié et fait servir leur âme. Tout le reste est mauvaise hagiographie. [1] Jean Duchesne, Bernard Goulay, L’affaire Jacques Fesch, Paris, éd. De Fallois, 1994. [2] Georges Bernanos, « Nos amis les saints », Tunis, 1947, in Les Prédestinés, textes rassemblés et présentés par Jean-Loup Bernanos, Paris, Seuil, « Points Sagesse », 1983.